Soutenue par l’énergie de quatre comédiens remarquables et une mise en scène épurée, la pièce reste d’une étonnante actualité
Je pensais connaître Les Justes. Camus, la révolution, la bombe, le dilemme moral. Je pensais être prête.
Et puis le spectacle commence, au Théâtre de Poche Montparnasse, et très vite je comprends que je ne vais pas assister à une oeuvre connue et bien jouée, mais à une mise à l’épreuve qui va me déranger doucement et durablement. Je vais entrer dans quatre consciences, toutes à vif, toutes brûlantes, toutes en équilibre sur un fil.
Préambule : la bombe et la conscience
Les Justes, c’est l’histoire de quatre jeunes révolutionnaires russes, en 1905 à Moscou, qui décident de commettre un attentat pour faire tomber le grand-duc – un acte politique destiné à frapper un pouvoir qu’ils jugent injuste. Mais Camus ne raconte pas seulement un complot : il s’intéresse surtout à l’âme humaine, au vertige moral, à la conscience en crise.
Leur plan initial échoue tragiquement lorsque des enfants apparaissent aux côtés du grand-duc. La question se pose alors avec acuité : peut-on sacrifier des innocents pour une idée, même pour en sauver des milliers d’autres ? Cette hésitation morale traverse tout le groupe.
Deux jours plus tard, l’attentat est finalement accompli. Yanek est arrêté. Confronté à la veuve du grand-duc, dévote et prête à lui accorder sa grâce s’il renonce à ses principes, il doit rester inflexible. Pour lui, il n’a pas tué un homme, mais un symbole de l’oppression et de l’injustice.

Un quatuor en tension
Chaque conscience affronte l’épreuve à sa manière, entre idéalisme et conscience, entre engagement et humanité. Rien n’est laissé au hasard. Annenkov (Étienne Ménard) commande la cellule : posture d’autorité et gravité contenue, il pèse les choix comme on pèse des vies. Dora (Marie Wauquier) est celle qui a fabriqué la bombe ; sa lucidité et sa délicatesse donnent au geste une étrangeté troublante — tendresse, détermination et danger mêlés. Stepan (Arthur Cachia) revient du goulag, brûlant d’impulsion : il rêve de lancer l’action, mais son ardeur inquiète, fissurant la cohésion du groupe. Enfin, Kaliayev, dit Yanek (Oscar Voisin), est le poète qui croit encore à l’humanité ; c’est à lui que revient le geste ultime, porté par une foi fragile et une grande beauté intérieure.
Leurs dialogues révèlent les doutes, les contradictions et les fragilités des personnages : faut-il tuer pour la justice ? Jusqu’où aller pour une cause que l’on croit juste ? Chaque mot pèse, chaque silence compte. La tension n’est pas seulement politique, elle est intime, presque physique, et se joue dans les respirations, les hésitations, les regards échangés sur scène. Et elle nous bouscule : car devant nous se conjuguent et s’affrontent volonté de mort, innocence, culpabilité, amour et respect de la vie, jusqu’au-boutisme et haine de la tyrannie, pardon … Comment rester insensibles et immobiles ?

La dynamique entre les quatre est magnétique. Les conflits, les désaccords et les hésitations ne sont pas théorisés, ils se ressentent physiquement, c’est impressionnant de justesse. Tout est fluide et évident. En tant que spectatrice, je n’ai pas reçu seulement le texte : je l’ai vécu, à travers la respiration des comédiens et la suspension de chaque instant.
Sobriété et précision : la signature d’Aboville
Pour sa première mise en scène, Maxime d’Aboville se distingue par la sobriété. C’est à souligner car ses choix intelligents de forme raccourcie du brillant texte de Camus facilitent la compréhension et la portée de la réflexion présentée. Le plateau est épuré, presque nu. Les décors n’encombrent jamais l’espace : l’attention reste concentrée sur les corps, les mots et les silences.
J’ai adoré la première scène silencieuse et le point de départ inquiet de la pièce : une lumière étroite, en bandeau, sur les yeux graves et attentifs d’Annenkov, à travers un soupirail. On comprend immédiatement qu’il se trouve dans une cave, un lieu de repli avec pour seul accès à l’extérieur un soupirail qui restitue quelques mouvements, quelques bruits, un peu de lumière de la rue au dessus. Les actions qui s’en suivent prennent appui sur cette lucarne qui permet un dedans/dehors très intéressant tout en préservant une (presque) unité de lieu de la pièce.
La lumière, travaillée avec soin par Alireza Kishipour, est parfaite pour souligner les tensions : elle met en valeur les instants de doute ou de décision. Une petite ampoule de l’espoir au filament rougi brille dans un coin, tant que l’action semble possible. Les ombres deviennent autant de personnages silencieux qui prolongent la parole et amplifient le vertige intérieur des protagonistes.
N’oublions pas la musique, signée Jason Del Campo, et les ambiances sonores discrètes mais essentielles. Un écho dans une geôle un peu trop froide et humide, le son des fers des chevaux qui battent le pavé lorsque passe la calèche du grand duc au dehors dans la rue, les souffles retenus par l’écoute et la peur : tout contribue à installer une atmosphère de huis clos moral, où la menace de l’action et la fragilité de l’humain se ressentent jusque dans le corps du spectateur. La bombe, ici, n’explose jamais devant nous. Elle est dans l’air, dans le texte, dans les regards et dans les hésitations — un catalyseur de conscience plutôt qu’un événement spectaculaire.

Pour le décor, Maxime d’Aboville a choisi, avec Charles Templon, de redonner vie à la toile peinte par Marguerite Danguy des Déserts pour Je ne suis pas Michel Bouquet. Un clin d’œil discret mais chargé de sens, puisque Bouquet fut l’un des premiers interprètes des Justes aux côtés de Reggiani et Maria Casarès. Cette toile, semblable à un grand rideau de fer usé par le temps, est magnifique ; elle apporte une force symbolique immédiate : une fermeture, une oppression, un monde qui se replie. Placée au fond, elle laisse devant elle un espace nu, presque ascétique. Elle dessine en creux l’appartement où se réunit la cellule révolutionnaire, mais surtout l’état mental des personnages : enclavé, confiné, sous tension.
Ce type de mise en scène — d’une grande rigueur, d’une grande retenue — n’est pas sans risque. À certains moments, la sobriété peut sembler austère. Il faut accepter le rythme lent, l’absence d’effet, la densité du texte — et cela demande d’entrer franchement dans le drame, sans chercher le confort. Mais c’est un pari. Et je crois qu’il est à la hauteur de Camus.
L’axe dramaturgique : l’épreuve intérieure
Ce que cette version des Justes rend si fascinant, c’est le recentrage sur l’épreuve intérieure. L’action politique — l’attentat — n’est jamais montrée comme un spectacle : on la devine, elle est racontée et elle devient, avant tout, un révélateur de la conscience.
J’ai ressenti que Maxime d’Aboville avait, dans tous ses choix, cherché à mettre l’accent sur la dimension psychologique et morale de la pièce plutôt que sur l’événement historique. Le dilemme de Camus — jusqu’où peut-on aller pour une idée juste ? — devient un questionnement intime, universel, qui dépasse l’époque ou le contexte historique.
Il est hyper intéressant de voir se tisser et se dérouler devant nous la complexité de cette décision, les contradictions de l’être humain et la fragilité de ses certitudes et permet de montrer la diversité des consciences. Chaque acteur révèle une facette différente de la question camusienne. Ensemble, ils tissent une lecture polyphonique et vivante de la pièce, qui rend Camus accessible et puissant aujourd’hui, sans chercher à l’édulcorer ni à le moderniser par des artifices.

Et après ?
Je suis sortie de la salle chancelante. Pas par l’émotion facile, par l’effet spectaculaire. Non. Par l’intensité silencieuse, par le poids des mots, des hésitations, des regards, du souffle. Et les comédiens me l’ont confié à l’issue du spectacle : on ne ressort pas inchangé d’une pièce si forte.
Si bien que j’ai eu envie de rester avec la question, longtemps après. De la laisser infuser. Dans un monde saturé d’images, de slogans, de violences bruyantes, cette version des Justes rappelle que le théâtre — quand il est à la hauteur — peut redevenir un “espace de pensée”, un lieu où l’on écoute un texte, où l’on ressent des êtres, où l’on s’interroge.
Et c’est, pour moi, la marque des spectacles qui comptent — ceux qui ne divertissent pas, mais transforment. Ceux qui dérangent mais éveillent. Voilà la valeur essentielle de ce spectacle : il redonne à Camus la force de nous atteindre — non comme un autoportrait d’un révolté d’hier, mais comme un miroir tendu vers notre actualité. Car on est au début du XXe siècle, et pourtant, les observations sur la Russie et son pouvoir résonnent encore malheureusement aujourd’hui …
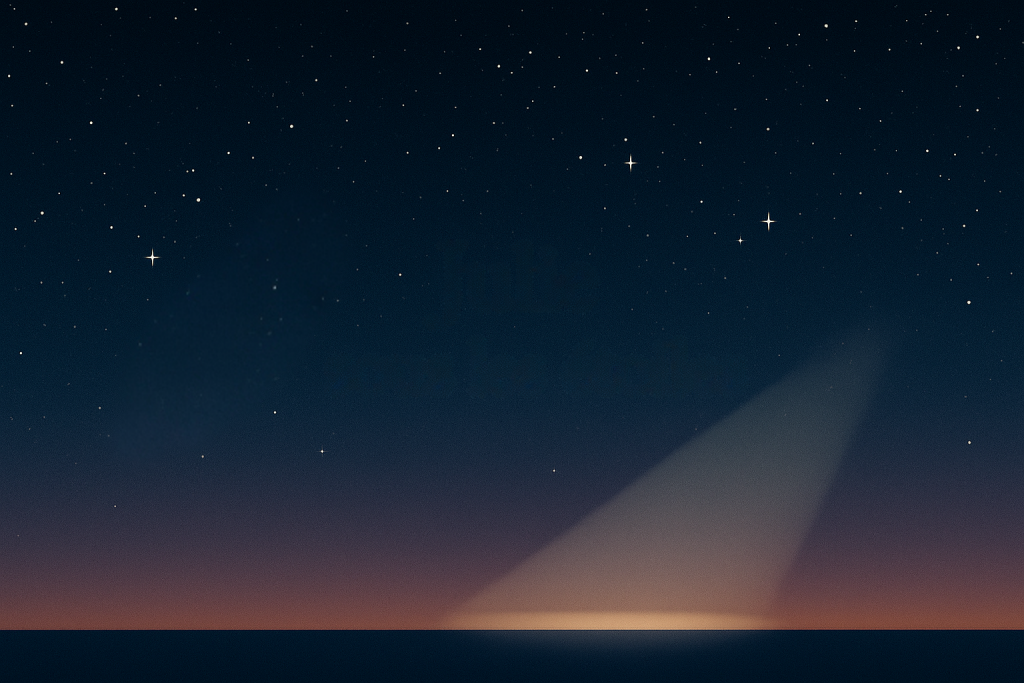
Crédits
Mise en scène : Maxime d’Aboville
Création costumes et scénographie : Charles Templon assisté de Pixie Martin
Création lumière : Alireza Kishipour
Création sonore : Jason Del Campo
Toile peinte de Marguerite Danguy des Déserts
Avec les comédiens : Arthur Cachia, Étienne Ménard, Oscar Voisin, Marie Wauquier
Au Théâtre de Poche Montparnasse
Du 2 septembre 2025 au 4 janvier 2026
Du mardi au samedi à 19 h, dimanche à 15 h.
Durée : 1h15
#Foncezauthéâtre !







