DU CHARBON DANS LES VEINES
Une fresque humaine, tendre et vibrante — comme un film projeté en direct
Il m’était urgent de venir découvrir Du Charbon dans les veines, la création de Jean-Philippe Daguerre aux 5 Molières, que j’avais raté cet été à Avignon … faute d’anticipation de l’engouement généré par la pièce, bref : COMPLET ! Il a fallu le temps d’attendre et ce que j’espérais s’est produit : cette jolie pièce a déposé sur moi une petite poussière de lumière. Il flottait ce soir sur la scène du Théâtre du Palais-Royal comme un parfum de cinéma populaire où l’on rit, où l’on retient son souffle, où l’on se sent soudain très proche de ceux qui, dans une autre époque, dans un autre coin de pays, ont pourtant vécu exactement comme nous. Ou peut-être mieux.
1958. Une commune du Nord-Pas-de-Calais. Alors que la France s’agite sous les derniers soubresauts de la IVe République, ici, la vie se raconte autrement : les hommes descendent dans les mines, les femmes tiennent, et les enfants apprennent à rêver malgré les corons.
Jean-Philippe Daguerre a construit une pièce chorale, où chacun apporte une vérité, une blessure, une drôlerie, une façon d’être au monde qui modifie subtilement la dynamique du groupe. Et la distribution de ce soir soir formait un merveilleux ensemble d’harmonie : tout était fluide, naturel, les gestes, les interjections, les rires, les dialogues qui s’enchevêtrent à dessein. Une troupe soudée, habitée, dont le travail choral fait la beauté du spectacle. Franchement, j’avais l’impression de faire partie de la famille et d’être à table avec eux un soir de froid et d’hiver.

Les personnages : humanité, fidélité et lumière
Didier Brice — un Sosthène d’une humanité bouleversante
Didier Brice ouvre la pièce par un élan de joie et de fraternité qui saisit immédiatement. Comme quand on vous ouvre les bras. C’est un de ces hommes que l’on pourrait croiser dans n’importe quel village ou cité ouvrière : le boute-en-train, le cœur qui déborde, l’âme généreuse qui donne tout, l’humour protecteur. Il traverse la scène comme un soleil fatigué, irradiant une chaleur inaltérable. Mais derrière l’éclat du rire, on sent affleurer ce que la mine laisse dans les veines : des douleurs rentrées, une santé qui tient comme elle peut, des secrets que la bonne humeur recouvre sans effacer. Didier Brice joue le rire comme une résistance, la bonhomie comme une pudeur, et la douleur comme une évidence. Il donne à son personnage une profondeur qui bouleverse sans jamais tomber dans l’effet.
Christian Mulot — l‘ami fidèle et indispensable
Christian Mulot incarne l’ami de toujours, que la vie a marqué profondément et qui porte sur ses épaules la trace de la perte et de la douleur. Déchiré par la mort de sa femme, toujours prêt à lever le coude au bistrot pour masquer sa peine, il soutient Sosthène avec constance, partage sa douleur, protège sa mémoire et sa vie avec une fidélité que rien n’ébranle. Et lorsque le moment de la disparition arrive, son rôle ne s’efface pas : il devient le pilier silencieux, celui qui veille et prend soin. Christian Mulot réussit à rendre palpable le poids du passé et la force de l’amitié. Ce type de rôle n’existe que lorsque l’acteur a une présence tranquille, sans esbroufe, et Christian Mulot possède vraiment ce talent.
Philippe Maymat — le médecin au cœur discret
Sous ses airs de taiseux du Nord, Philippe Maymat incarne le médecin de famille avec une humanité rare. Contrepoint parfait aux figures plus flamboyantes du bistrot, il reste fidèle à sa mission essentielle : protéger, soutenir, consoler. Sans jamais appuyer son jeu, il incarne ce que la France du Nord des années 60 avait de plus précieux : des hommes simples, instruits sans arrogance, dévoués sans réclamer la moindre gratitude, des figures de confiance qui faisaient tenir une communauté entière.
Théo Dusoulié — la jeunesse qui rêve et qui saigne
Pierre, incarné par Théo Dusoulié, est la voie d’avenir, celle qui hésite entre rester ou partir, entre tradition et désir de s’arracher au destin de la mine. Son jeu est d’une pureté lumineuse, avec des élans d’enfant et des fractures d’adulte déjà trop lourdes. Il incarne à merveille ce moment de la vie où l’on croit encore que partir suffit à tout changer, même si l’amour, la famille ou l’amitié nous retiennent aux portes de la liberté.
Yasmine Haller — la force des femmes
Leïla, jeune femme marocaine dont la famille a émigré depuis plusieurs années, rappelle ces figures du Nord qui tiennent les murs, les secrets, les hommes, les familles. Dans ce Nord encore bordé de conservatismes, où la mine dicte le rythme et où l’on ne quitte pas facilement les limites du quartier, Leïla incarne la possibilité du déplacement — physique, émotionnel, culturel. Elle arrive avec sa part de mystère, ses fragilités et cette force tranquille des jeunes femmes qui savent déjà trop tôt où elles n’iront pas, mais pas encore exactement où elles rêvent d’aller. Et Yasmine Haller porte ses scènes avec une force calme, une densité intérieure.
Sophie Artur — l’intimité, la discrétion, la vérité
Sophie Artur amène une couleur différente : un regard qui voit tout, une réserve qui parle fort, et cette émotion fragile qui affleure lorsqu’elle se tait. Dans certaines scènes plus silencieuses – lorsqu’elle essuie un verre en observant ses clients s’écharper autour d’un match de foot, ou quand elle se penche légèrement pour écouter une confidence difficile – elle devient presque un personnage de cinéma. On pense à ces héroïnes de Pialat ou de Tavernier, femmes de trempe et de lumière, qui portent la vérité des lieux sans en faire étalage. Sa force est de rendre visible ce qu’on ne montre jamais : le travail émotionnel, patient, quotidien, de celles qui soutiennent les autres sans jamais réclamer reconnaissance. Elle est l’ancre de la pièce, et lorsqu’elle quitte un instant la scène, on sent comme un vide, une absence de chaleur.
Arnaud Dupont — les silences qui brûlent
Quant à Arnaud Dupont, il offre un contrepoint magnifique : un personnage qui parle peu, mais dont chaque silence ouvre un monde entier et des émotions fortes de douleur liée à la perte prématurée de sa maman, de colère, d’envie de son meilleur ami … Dans cette pièce où l’on rit beaucoup, il est la faille, le mystère, la vérité têtue qui flotte entre les lignes. Arnaud Dupont incarne cette figure qui n’a pas besoin d’élever la voix pour exister. Il impose sa présence par la précision de ses gestes, la justesse de ses regards. On sent chez lui un passé épais, jamais explicité mais toujours là.
La mine : ombre silencieuse et force invisible
La mine est partout et nulle part. Elle n’est presque jamais montrée, mais elle hante chaque scène. Elle est cette présence invisible qui façonne les corps et les vies, qui marque les hommes de poussière, de maladies et de fatigues, et parfois les arrache prématurément à leurs familles. Jean-Philippe Daguerre gravite autour de la mine avec une délicatesse magistrale : il ne la met jamais au centre, l’évoque en arrière plan, ne la diabolise pas. Et pourtant, elle irrigue tout ; elle est ce poids invisible que tous apprennent à porter, ce lien silencieux qui construit la communauté autant qu’elle la fragilise.

Une mise en scène cinématographique et un décor vivant
Evidemment la mise en scène ne m’a pas laissée indifférente ! Le décor est une merveille d’intelligence théâtrale : une scène séparée en deux espaces distincts, presque deux mondes. À gauche, le bistrot de Simone : lieu intime, communautaire, l’endroit où passent toutes les vérités, les secrets, les potins, les peurs, les amours tus — bref, la vie. À droite, la petite maison, le jardin, la cage aux pigeons, la mine qui ne se montre jamais mais qui est partout.

Cette alternance crée un rythme cinématographique, comme des coupes, des travellings, des focales soudaines sur une conversation, un geste, un silence. On bascule d’une table en bois collante de bière à un banc de jardin où l’on refait le monde. Le dispositif est d’une fluidité extraordinaire, sans aucune lourdeur : tout glisse, tout respire, tout s’enchaîne avec une précision presque musicale. Décors et costumes très bien pensés qui aident à se projeter dans le monde de ces braves gens.
Le rythme est un chef-d’œuvre de précision. Tout s’enchaîne au millimètre, comme si chaque geste avait été chorégraphié pour laisser place à la vie. C’est une mécanique au cordeau, mais qui ne se voit jamais. Le spectateur ne perçoit que l’évidence des transitions, la douceur des changements de lieu, la respiration commune des personnages. Ce travail d’horloger donne à la pièce une allure de film que l’on déroulerait en direct : on s’attache aux personnages comme on s’attacherait à ceux d’un long-métrage, on attend leurs retrouvailles, leurs dérapages, leurs réconciliations.

Des scènes qui restent et la magie de l’accordéon
Je vais le dire : j’ai adoré me promener dans ce passé étranger mais familier ! La plupart des scènes semblent sorties d’un film français des années 60 et restent en mémoire longtemps après la chute du rideau. L’entrée au bistrot où les personnages se croisent, s’interpellent, se chamaillent, se saluent, créant en quelques minutes un univers entier. L’arrivée de la télévision, objet presque magique qui devient soudain la fenêtre du quartier sur la Coupe du monde, est un moment de comédie pure, mais traversé d’une émotion toute simple : celle de partager quelque chose de nouveau, ensemble, avant que la modernité ne sépare les vies au lieu de les rassembler.

L’accordéon, omniprésent, n’accompagne pas : il devient un personnage à part entière. Sa voix est celle de la nostalgie, mais aussi celle de la joie ; celle des bals improvisés, des fêtes de village, des tendresses murmurées à la sortie d’un estaminet. Cet accordéon-là n’est pas un cliché du Nord : c’est son cœur battant, un lien entre tous, un fil rouge émotionnel qui porte toutes les nuances de la pièce : la nostalgie, la fraternité, l’amour des petites choses, l’envie de danser malgré tout.
Ce qui frappe chez Jean-Philippe Daguerre, c’est cette aptitude précieuse à tisser le quotidien et la grande Histoire avec une légèreté qui n’ôte rien à leur gravité. Et c’est tout simplement beau et très tendre.
La beauté et la tendresse d’une France populaire
Ce qui bouleverse, dans Du Charbon dans les veines, c’est peut-être la manière dont la pièce parle de la France. Pas la France de cartes postales ; la vraie. Celle des ouvriers, des familles nombreuses, des femmes debout, des copains de bistrot, des espoirs modestes, des bagarres qui n’en sont pas, des secrets que l’on garde pour protéger les autres. Une France dont on dit parfois qu’elle est oubliée, alors qu’elle continue d’habiter profondément notre imaginaire collectif.
La pièce rappelle la dignité des ouvriers, la fierté silencieuse des mineurs, la force des femmes, la fraternité des communautés, les rêves minuscules mais essentiels, l’amour des choses modestes : un verre de bière, un match de foot, une chanson, un repas partagé. Elle dit surtout que ce qui tient les gens debout n’est pas la facilité, mais la tendresse. Et c’est cette tendresse, omniprésente, qui bouleverse.
Jean-Philippe Daguerre, ici, ne fait pas un théâtre nostalgique. Il écrit une fresque de lumière. Il rappelle que ceux qui avaient peu donnaient souvent beaucoup ; que la solidarité n’était pas un mot, mais un geste ; que les existences les plus modestes sont parfois les plus grandes.
Un théâtre qui se vit comme un film
Ce spectacle réussit ce que le cinéma italien populaire faisait merveilleusement :
raconter la vie telle qu’elle est, sans chercher l’effet, sans forcer l’émotion. Au cours de la pièce, j’ai eu quelques flash de Cinema Paradiso ce chef d’oeuvre à la lenteur choisie et représentative de la vie qui se vit. C’est sans doute pour cela qu’on a l’impression d’être dans un film. Parce que la pièce possède ce grain, cette densité, cette vérité des histoires humaines profondément ancrées dans leur époque — et pourtant universelles.
Je trouve important de montrer que dans les milieux populaires, dans les cercles de braves gens qui ont des vies difficiles il y a une communauté, une amitié, une fraternité qui fait que la vie vaut le coup d’être vécue malgré la difficulté du sort que l’on peinait considérer que l’on est.
Quand les lumières se rallument, on garde en soi une musique d’accordéon, un rire suspendu dans la fumée d’un bistrot, les pleurs qu’on n’a pas versés mais qui bruissent quelque part, et cette sensation douce que ces gens — Sosthène, Simone, Pierre, les autres — auraient pu être nos oncles, nos voisins, nos grands-parents.
Du Charbon dans les veines est une pièce qui raconte les gens qui ont peu — mais qui donnent tout. Un théâtre de cœur, de chair, de vérité et de véritable tendresse. Et ça, ça ne s’oublie pas.
#Foncezauthéâtre !
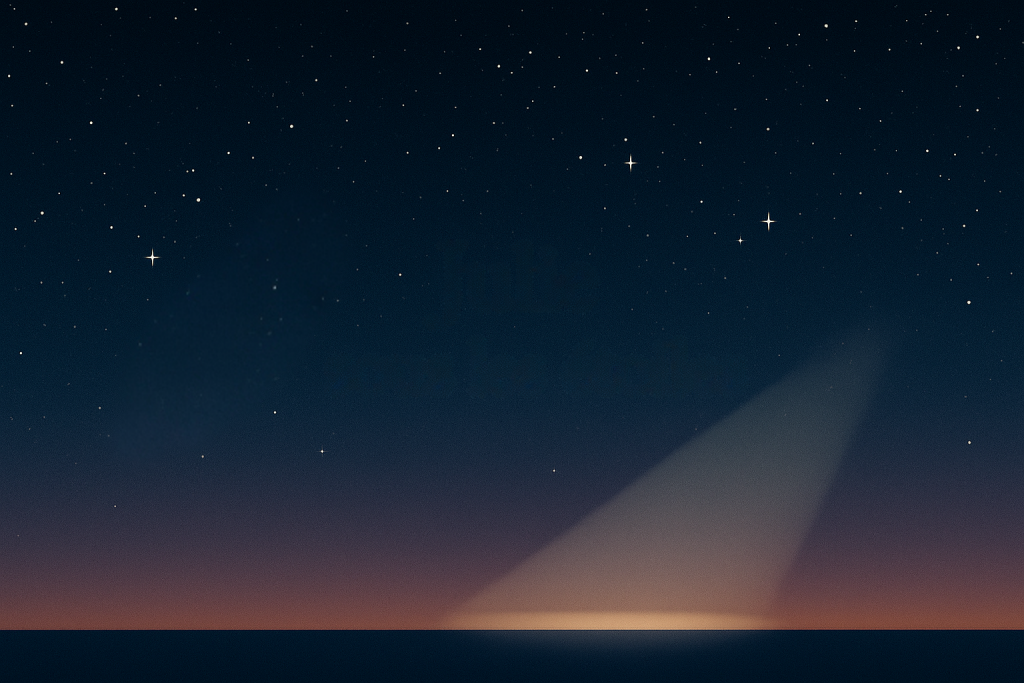
Crédits
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Décors : Antoine Milian
Costumes : Virginie H
Création lumière : Moïse Hill
Musique et assistant mise en scène : Hervé Haine
Avec les comédiens : Jean-Jacques Vanier ou Didier Brice, Aladin Reibel ou Christian Mulot, Raphaëlle Cambray ou Sophie Arthur, Théo Dusoulié ou Basile Alaïmalaïs, Julien Ratel ou Arnaud Dupont, Juliette Behar ou Yasmine Haller ou Garance Bocobza, Jean-Philippe Daguerre
Au Théâtre du Palais-Royal
Jusqu’au 3 mai 2026
Mardi et jeudi à 20h30, samedi à 19h, dimanche 15h30
Durée : 1h20







